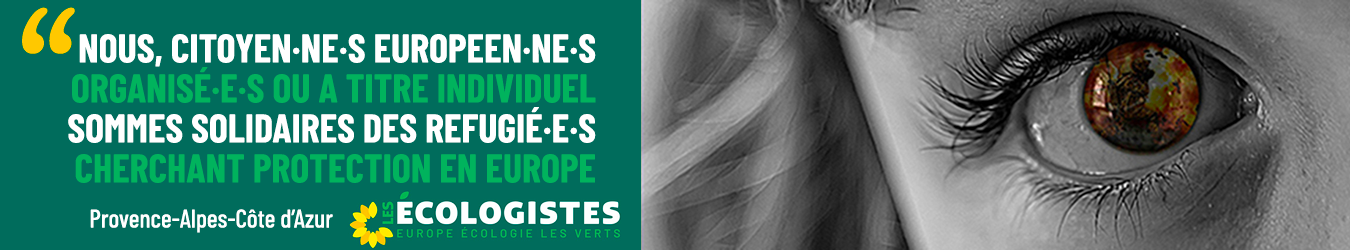Cela fait plusieurs fois que des interlocuteurs me demandent un papier publié au début du mois. Quatre pages dans le magazine du samedi, le 1er juin, au sujet de l’investissement, depuis une dizaine d’années à Marseille, de travailleurs sociaux pour comprendre les réseaux de vente de cannabis. Leurs structurations, leur emprise sur les mineurs. Les conditions d’embauche et de débauche, les gains, les risques. Ceci afin de réfléchir à leur mission, d’adapter leur travail, leurs réponses. Un boulot passionnant, qui débouche sur d’autres groupe de travail, de parents et de jeunes consommateurs. Et sur des propositions difficiles à faire accepter, mais permettant de sortir de l’illusion que l’on va arracher à court ou moyen terme les trafics qui gangrènent une partie de la vie sociale des cités. Le voici en accès libre, ce sera plus simple…
Début des années 2000 dans les quartiers Nord de Marseille. Des éducateurs constatent le rajeunissement des acteurs dans les réseaux de vente de cannabis, une augmentation de l’emprise des trafics sur les cités et les gamins recrutés. Avec les embrouilles, les violences, que cela implique. Comment continuer à travailler dans ce contexte ? Comment partager le territoire avec ces réseaux ? Et puis comment ces derniers fonctionnent-ils au fait ? Quel est leur impact sur les adolescents, les habitants, les familles ? Comment y entre-t-on, en sort-on ? Et jusqu’où un éducateur peut-il aller ? Pour répondre à ses questions, quelques travailleurs sociaux, soutenus par des sociologues, mènent depis dix ans un travail collectif, devenu essentiel. «On avait besoin de savoir ce qui se jouait, résume Anne-Marie Tagawa, éducatrice spécialisée, en poste depuis une trentaine d’années dans les quartiers Nord de Marseille. Cela changeait trop de choses dans notre travail. Devions-nous continuer à entretenir la proximité avec ces jeunes, même lorsqu’ils s’impliquaient dans des réseaux ?»
Les travailleurs sociaux se sont d’abord tournés vers leur hiérarchie pour trouver des réponses. Mais les institutions étaient fuyantes. Pour elles, les dealers relevaient de la police, de la justice. Pas du travail social. «Tu n’as pas à fricoter avec les dealers, cela ne fait pas partie de ta mission. Si tu as des ennuis, ne viens pas te plaindre», s’est entendu répondre une animatrice de prévention. «A l’Institut régional du travail social, explique Claire Duport, sociologue qui accompagne un groupe de travail, on forme des éducateurs sur un cursus de trois ans. Mais pas une heure n’est consacrée au fonctionnement des réseaux qu’ils vont trouver sur leur route en sortant.» Aux travailleurs sociaux de se débrouiller, en première ligne, avec leurs questions.
Educateur et pas informateur
Alors certains ont décidé de partager leurs connaissances. Puis l’Addap13 (Association départementale pour le développement des actions de prévention des Bouches-du-Rhône), employeur d’éducateurs spécialisés, a lancé un groupe baptisé Questions de réseaux. S’y côtoient des éducateurs, des animateurs de prévention et quelques représentants de bailleurs, accompagnés par un sociologue (poste financé par une petite structure qui dépend de la ville de Marseille, la Mission sida, toxicomanies et prévention des conduites à risque, mise en place au milieu des années 90). Cette dernière a conseillé d’opter pour un analyste du travail, plutôt qu’un spécialiste des drogues. Et Pierre Roche, sociologue au Cereq (Centre d’études et de recherches sur les qualifications), a aidé les travailleurs sociaux à y voir plus clair dans leurs dilemmes professionnels. Un premier ouvrage collectif, la Proximité à l’épreuve de l’économie de la débrouille (Cereq), a été publié sous sa direction en 2005.
«Comment entendre des confidences, fréquenter des lieux de deal fermés sans avoir l’impression de les cautionner ni passer pour des complices aux yeux des habitants et des partenaires qui vous voient traîner avec des trafiquants ?» interroge Pierre Roche. La police, notamment, peine à comprendre qu’un éducateur ne peut pas également être un informateur ou un dénonciateur, au risque de se mettre en danger et de briser la confiance établie avec les adolescents qu’il doit protéger. Alternative infernale pour les éducateurs : côtoyer les réseaux afin de maintenir ce lien, au détriment du respect de la loi, ou bien s’appuyer sur celle-ci et prendre leurs distances avec ces jeunes gens qu’ils sont censés protéger.
Pierre Roche a fait réfléchir les éducateurs sur l’éthique de la fidélité, à partir de travaux du philosophe Alain Badiou (1). «A qui dois-je rester fidèle ? A la loi ou au jeune que je dois protéger ? Aux deux en fait, résume Karima Berriche, sociologue de formation et directrice du centre social de l’Agora, dans le quartier de la Busserine. Et pour un travailleur social, le seul moyen de concilier cela est de quitter les postures moralistes et s’inscrire dans la durée.» Maintenir des liens afin d’être prêt au moment où une faille se présente, espérer influer sur le parcours d’un adolescent. «Mais le travailleur social ne sait jamais quand ce moment va venir, relève Pierre Roche. En ce sens, il est un guetteur.»
Situations de «quasi-servage»
Le groupe Questions de réseaux se réunit au moins une fois par mois. Rien de ce qui se dit ne peut être raconté à l’extérieur sans accord unanime, car les participants examinent des histoires vraies. L’un d’eux rapporte une situation, puis tous échangent leurs connaissances sur le sujet avant de passer à un nouveau cas. Les séances sont enregistrées, le sociologue en fait une retranscription écrite qui est envoyée à chaque membre avant la séance suivante.
Pour eux, il s’agit de comprendre le fonctionnement des réseaux de vente de cannabis, afin de trouver des stratégies plus fines, des arguments pour tenter d’empêcher les adolescents de se laisser aspirer. «Cela nous ramène à notre mission initiale. Les protéger et non les juger», glisse une participante. Se sentir moins impuissant aussi. Aiguiser son regard pour savoir interpréter des attitudes, des mots, des micro-événements. Parfois, pour creuser un aspect qu’ils maîtrisent moins, les éducateurs invitent un intervenant extérieur, qui peut être un anthropologue, un économiste, un magistrat…
«Au départ, ils étaient assez désarmés. Ils n’en savaient pas tant que ça sur ces réseaux de vente», remarque Claire Duport, la sociologue qui a succédé à Pierre Roche. Les travailleurs sociaux ont travaillé au fil des années sur leurs fonctionnements – comprenant au passage qu’il n’y avait pas de modèle. La sociologue Amina Haddaoui est venue leur expliquer comment les cités avaient accédé au trafic de semi-gros dans les années 80, quelles porosités s’étaient créées avec le banditisme, puis quelles atomisations avaient permis la multiplication des micro-entreprises, la «dispersion spatiale des marchés de détail» (2).
Pascale Jamoulle, une anthropologue belge, leur a parlé des «troubles de l’exil», expliquant comment des «jeunes en vide de transmission, très acculturés, « téléchargent » tels quels les modèles du capitalisme marchand». Nacer Lalam, chargé de recherche à l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice, leur a décrit la «violence insidieuse» au sein des réseaux. Les situations de «quasi-servage» lorsque des trafiquants fabriquent des dettes aux plus jeunes pour les forcer à travailler pour eux.
Des héros «positifs» tombés depuis longtemps
Les éducateurs voulaient aussi comprendre comment on entre dans ces réseaux. «Souvent, cela se fait de façon implicite, explique Claire Duport. On commence par rendre service, puis on fait quelques remplacements, pour dépanner. Le sentiment d’appartenance ne vient qu’à la première gifle qu’on reçoit parce qu’on a fait une connerie.» L’appât du gain, de l’argent facile, est-il le principal moteur, comme on le dit souvent ? «Ils viennent chercher de l’argent, répond l’éducatrice Anne-Marie Tagawa, mais aussi de la reconnaissance, des modèles d’identification, une socialisation, une valorisation.» D’autres éducateurs évoquent le besoin d’investir un contre-monde ou la recherche d’adrénaline. L’impression d’être redevable, lorsque le réseau a aidé à résoudre une embrouille.
Questions de réseaux s’est aussi posé la question des gains. Dans la plupart des cités, les héros «positifs» sont tombés depuis longtemps, détrônés par ceux qui peuvent exhiber une réussite. Des gamins pensent que le réseau met à leur portée de l’argent facile. En réalité, les positions lucratives sont réservées à quelques-uns, aux organisateurs. Les autres, une grande majorité, constituent un prolétariat sans syndicat, maintenu sous pression pour des gains relatifs. L’économiste Christian ben Lakhdar (3), venu travailler avec Questions de réseaux, estime que «le rapport entre le coût et le bénéfice est irrationnel». Rapporté aux volumes horaires, le salaire de la vente au détail atteint rarement les niveaux que l’on trouve à compétences égales dans la légalité.
Seulement, le travail légal se fait rare sur ces territoires, alors que les réseaux embauchent à tour de bras. «L’attrait financier ne se comprend qu’en tenant compte de l’état économique et social de ces lieux», conclut Christian ben Lakhdar. Comprendre cette précarité «aide à déconstruire» des illusions que les jeunes impliqués dans les réseaux sont les premiers à conforter, «en brandissant, par exemple, des liasses de billets, tout en omettant de dire que la plus grande partie doit être reversée à leur patron», écrit Pierre Roche (4). Mieux informés, les éducateurs s’emploient à déconstruire ces fantasmes dans la cité.
La «chouf», puis le «charbon»
Le groupe s’est aussi penché sur les «moments de basculement» qui favorisent l’entrée dans le réseau. L’arrivée au collège, avec les aînés que l’on craint, ou que l’on veut séduire en leur rendant service. Les périodes de déscolarisation, qui privent de cadre de socialisation. Il s’agit donc de resserrer les liens avec les collèges de certaines cités pour prendre en charge les exclus au centre social.
D’autres périodes semblent au contraire propices aux décrochages. La rencontre amoureuse, la sortie de prison, lorsque le libéré a le sentiment de ne pas avoir été très soutenu par son réseau. «Mais cela ne dure pas longtemps, murmure la directrice du centre de l’Agora, Karima Berriche. Les jeunes sortent avec un sentiment très fort de déchéance, de dévalorisation. Il faut alors pouvoir proposer une alternative, sinon ils seront repris par le réseau, qui valorise les séjours en prison, en fait des passages initiatiques, tout en offrant un moyen de subsister. Il faut aller très vite. Ces réseaux sont plus réactifs que nous…»
Dans le quartier de la Busserine, la démarche a débouché sur un travail associant des habitants, des parents et des travailleurs sociaux. «Nous ne pouvions pas continuer à réfléchir sans les principaux intéressés», résume Karima Berriche. Un groupe appelé Habitants à l’épreuve des trafics se réunit régulièrement depuis janvier 2012 avec le sociologue Salvatore Condro. Là, les «experts ordinaires» racontent leur exposition au réseau. Ils voient la montée de la violence qui obsède leurs enfants. La plupart connaissaient Iskander, mineur abattu d’une douzaine de balles en mai. Ils savent que l’on a retrouvé 23 orifices sur son corps. Ils participent ce samedi à une grande marche contre les violences, entre la gare Saint-Charles de Marseille et la préfecture (lire).
«Les trafics, décrivait Fatma au cours d’une séance, c’est comme une verrue qui vous colle à la peau et dont on n’arrive pas à se débarrasser. Beaucoup de gens ont peur pour leurs enfants, mais comment faire quand on n’a pas les moyens de déménager ?» Un père disait l’humiliation de passer en silence avec ses enfants devant des dealers, alors qu’il leur parle à la maison des dangers de la drogue. «On n’est pas en mission, on n’a pas de guerre à mener, précise Céline, mère de six enfants. Ce qu’on veut, c’est comprendre comment ça fonctionne pour protéger nos jeunes.» Il y a une dizaine d’années, elle-même a vu son aîné «pris dans le trafic». Il avait commencé par le «chouf» (le guet) pour 30 à 40 euros par jour, puis il est passé au «charbon» (la vente). Il voulait «se faire du fric», pour «se faire voir». Disait que c’était «provisoire». Elle venait de se séparer de leur père, travaillait beaucoup, était souvent absente. «Ils s’en prennent aux plus faibles, dit-elle. Quand vous êtes une femme seule, vos enfants deviennent des proies.»
«N’importe qui peut être concerné»
Elle a fait la guerre à son fils, puis au réseau qui ne le laissait pas décrocher. «Ils le menaçaient, le frappaient, lui disaient on va faire ça à ta sœur, on va faire ci à ton frère.» Alors elle a déposé plusieurs plaintes, mais les policiers lui auraient dit que son affaire était classée parce que son fils avait «le cul merdeux», qu’il était impliqué dans le trafic. Sa porte a été vandalisée, une balle a traversé une vitre du salon, des sacs-poubelles enflammés ont été jetés sur le balcon de sa cuisine. Puis un jour, elle a réussi à rencontrer celui qui organisait le point de vente. «Il m’a dit que ce n’était pas une femme qui allait le menacer. Je lui ai répondu que ce n’était pas une femme qu’il avait en face de lui, mais une mère. Que je m’en battais les flancs de son business et que je mettrai son réseau en danger s’il ne lâchait pas mon fils parce que j’étais prête à crever pour lui.» Son aîné a finalement pu décrocher. Il est resté près d’un an à la maison, sans sortir, a mis du temps à se resocialiser. Il ne vit plus là, sera papa dans quelques semaines.
Ce genre de récit a permis à Nasser, père de famille moins directement concerné, «de comprendre qu’il n’y a pas que des parents démissionnaires». Que, dans un quartier comme le leur, «n’importe qui peut être concerné». Céline lui a aussi fait réaliser à quel point on se sentait seul dans ce combat, quand on n’est pas complice. «Tout le monde est contre les trafics, tout le monde s’en plaint, dit-elle. Mais vous ne trouvez plus personne pour vous aider. Ni les bailleurs, ni les élus, ni la justice.»
Ces temps-ci, une autre mère, comorienne, se débat avec son fils pour le faire décrocher d’un réseau. Il vient de passer un an en prison, lui avait écrit de la maison d’arrêt : «Je veux renaître.» Il voulait qu’ils déménagent pour échapper à toute influence. Mais ses parents n’en ont pas les moyens. A sa sortie, des adultes proches de la famille l’ont attrapé les uns après les autres, pour lui faire la morale, lui parler de la honte, de la réputation qu’il leur faisait. Ce qui peut nourrir un peu plus le sentiment de déchéance. Le fils a replongé. La mère se décourage, n’y croit plus. «La sortie du réseau n’est pas toujours brutale, lui expliquait doucement l’éducatrice l’autre soir. Il y a des allers-retours, des échecs. C’est normal d’être fatigué, découragé. La question à se poser, c’est comment relayer les parents, les soutenir dans ces moments-là.»
Ces groupes de travail commencent à être reconnus. Un nouveau s’est lancé à la Busserine, avec des adolescents en «surconsommation» de cannabis. Les sociologues qui accompagnent ces groupes sont désormais sollicités par d’autres villes, à Sevran (Seine-Saint-Denis) par exemple. Des expériences sont menées en Ile-de-France, à Toulouse.
A Marseille, la Mission sida, toxicomanies et prévention des conduites à risque tente de mettre en réseau tous ceux qui sont concernés. «Lorsqu’un jeune de 16 ou 17 ans a déjà programmé une carrière dans le trafic, qu’il est déterminé, il n’y a pas grand-chose à faire, dit Patrick Padovani, médecin et adjoint UMP de la ville. Pour les autres en revanche, il faut s’appuyer sur les travailleurs sociaux, leur permettre de rester dans la proximité, en les maintenant à l’écart des dispositifs répressifs.»
Trafiquant à mi-temps
Depuis près de quinze ans, Questions de réseaux s’est renouvelé régulièrement. Quelques anciens sont encore là, d’autres arrêtent, des nouveaux arrivent. Le groupe continue à nourrir l’expertise sur les réseaux, et à proposer des solutions. Parmi les pistes actuelles : la réduction des risques. Plutôt que de rêver à une improbable disparition soudaine des réseaux, pourquoi ne pas faire avec la réalité, négocier quelques points importants ? Obtenir que les plus jeunes ne soient plus embauchés au guet ? Que la vente ne se fasse plus sur les lieux de passage ? Que les produits les plus dangereux ne soient pas vendus ? Que ceux qui veulent décrocher puissent commencer par trafiquer à mi-temps ? Difficile à défendre, cette option réaliste peut être comprise comme un renoncement. Une acceptation des trafics. Sauf que dans les années 90, les politiques de réduction des risques liés au sida chez les toxicomanes suscitaient les mêmes réactions. Et elles ont bel et bien fini par être acceptées – sans doute parce que la progression de la maladie menaçait toute la population. Ce qui n’est pas le cas de l’exposition aux réseaux de drogue, limitée à certains quartiers.
Des travailleurs sociaux réfléchissent aussi à l’hypothèse d’une validation des acquis. Pour transférer dans un emploi légal des compétences forgées dans l’illégalité. Mine de rien, le trafic de drogue implique un sens de la comptabilité, des relations commerciales, de la négociation, de l’assiduité… «Contrairement à ce qu’on imagine, souffle Céline, la mère qui a repris son fils à un réseau, beaucoup échangeraient volontiers leur présence dans le trafic contre un petit taf déclaré.»
Olivier Bertrand
1) «L’Ethique, essai sur la conscience du mal», Hatier, 1994.
2) «Le Trafic de cannabis : des filières euroméditerranéennes aux réseaux locaux marseillais» dans «l’Intervention sociale à l’épreuve des trafics de drogue», sous la direction de Claire Duport, 2010, www.dat974.fr/spip.php?article5829.
3) «Le Trafic de cannabis en France. Estimation des gains des dealers afin d’apprécier le potentiel de blanchiment», OFDT, 2007.
4) «Prévenir l’implication des jeunes dans le trafic de drogue», Bulletin de recherche emploi-formation du Cereq, Bref n°306, février.
Libération, le 12 juin 2013 :
http://marseille.blogs.liberation.fr/henry/2013/06/marseille-%C3%A0-l%C3%A2ge-du-fr%C3%A8re.html